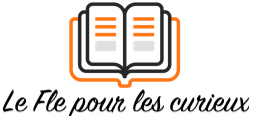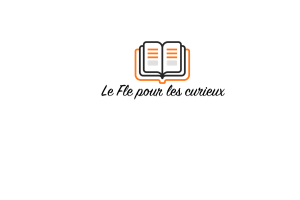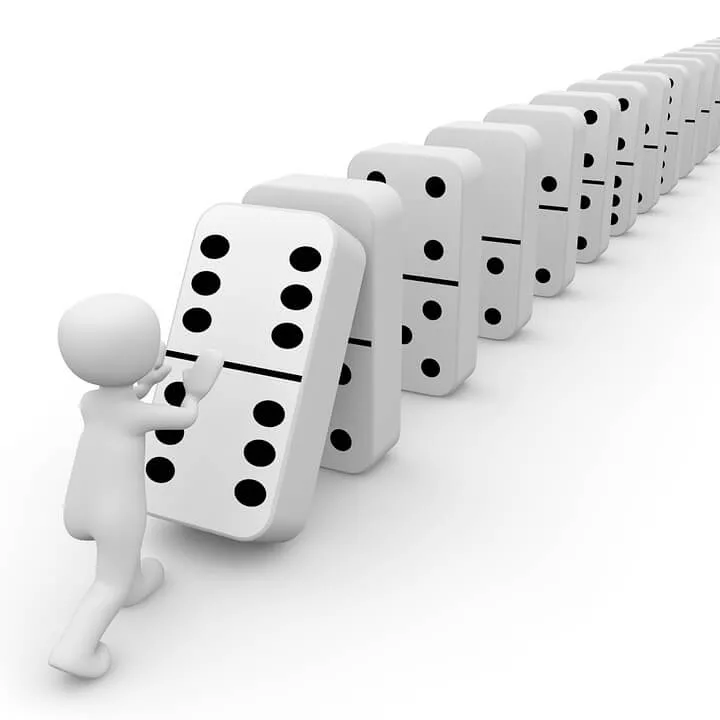Les notions de cause, de conséquence et de but jouent un rôle essentiel dans l’expression des relations entre des faits, des actions ou des idées en français. Il est impératif de bien les distinguer.
1. Nature
Pour exprimer ces concepts, on peut utiliser des propositions (subordonnées ou coordonnées), des adverbes ou des groupes prépositionnels. Ces trois catégories grammaticales permettent de construire des phrases exprimant la cause, la conséquence et le but.
2. Fonction
Tous les termes suivants remplissent la fonction de complément circonstanciel, indiquant qu’ils expriment une circonstance entourant une action ou décrivent un événement.
La conjonction peut être de coordination ou de subordination. En coordination, elle relie des propositions coordonnées, tandis qu’en subordination, elle introduit des propositions subordonnées. La différence fondamentale réside dans l’utilisation fréquente du mot « que » dans la subordination, bien qu’il puisse parfois être employé à d’autres fins.
| Conjonctions | Groupe prépositionnel | + |
Raison | Coordination : en raison de Subordination : car c’est la cause | À cause de, pour cette raison | Utilisation de la ponctuation : les deux-points « : ». |
Effet | Coordination : et, donc Subordination : si bien que, de telle sorte que, de manière à | Avec pour conséquence, aboutissant à | L’utilisation d’adverbes tels que alors, ainsi, et donc |
Objectif | Subordination : afin que + subjonctif | Dans le but de, pour, en vue de + verbe à l’infinitif ou nom |
|
3. Définitions
La cause représente l’élément déclencheur d’une situation. Par exemple, la belle journée peut engendrer ma joie et mon contentement.
La conséquence, quant à elle, désigne ce qui résulte logiquement d’une action. Bien qu’elle puisse ressembler à la cause, elle survient après l’action. Dans ce contexte, on peut affirmer que le fait d’être heureux est la conséquence de la belle journée.
Le but représente l’objectif pour lequel une action est entreprise. En général, il est lié à une intention claire et consciente de la part de quelqu’un, plutôt que le fruit du hasard. Le but est exprimé à l’aide d’outils linguistiques similaires à ceux de la cause et de la conséquence, bien que relevant de catégories grammaticales distinctes.
A. But
Pour exprimer le but, on a davantage recours à des conjonctions de subordination telles que « pour que » et « afin que » suivies du subjonctif. Par exemple, « je viens aujourd’hui afin que tu puisses me parler » requiert l’utilisation du subjonctif en fonction du temps employé au début de la phrase.
B. Conséquence
Pour exprimer la conséquence, les conjonctions de coordination « et » et « donc » sont fréquemment utilisées. Dans l’exemple « je suis venue et j’ai vu qu’il n’était plus là », le terme « et » indique la conséquence : ma venue est suivie de l’observation de quelque chose que je n’aurais pas pu voir autrement. Le terme « donc » fonctionne de manière similaire, bien que la phrase puisse paraître plus lourde. Par exemple, « Je suis venue donc j’ai constaté qu’elle n’était pas là » ou « je suis venue et j’ai donc constaté qu’elle n’était pas là ». « Donc » coordonne les deux parties de la phrase pour montrer le lien de conséquence entre elles.
Les conjonctions de subordination utilisées pour exprimer la conséquence incluent « si bien que », « de sorte que », et « si…que ». Par exemple, « je suis venue si souvent que j’en ai finalement eu assez », exprime une conséquence liée à la première partie de la phrase qui décrit une autre situation.
C. Cause
Pour exprimer la cause, la conjonction de subordination « parce que » est couramment utilisée pour introduire une proposition subordonnée de cause. En coordination, le mot « car » peut également être employé pour exprimer la cause dans une phrase.
D. Groupes prépositionnels
En ce qui concerne les groupes prépositionnels, l’élément « pour » est omniprésent et peut être utilisé pour exprimer la cause, la conséquence et le but. L’interprétation dépend du contexte de la phrase. Pour exprimer la cause, on peut également utiliser des expressions telles que « par » et « en raison de ». Pour la conséquence, l’expression « jusqu’à » est courante, tandis que pour le but, on utilise « en vue de » ou « afin de » suivis d’un verbe à l’infinitif ou d’un nom. Par exemple, « pour aller marcher » ou « pour Marie ». Les deux constructions sont possibles pour des prépositions telles que « j’ai un cadeau pour Marie » (le but est de le lui donner) ou « j’ai un cadeau pour le donner à Marie ».
E. Ponctuation
Enfin, la cause peut également être exprimée à l’aide de la ponctuation, telle que les deux-points (:). Par exemple, « je suis venue : j’ai vu qu’il n’était plus là ». Dans ce cas, les deux-points indiquent la cause. La conséquence peut également être exprimée à l’aide d’adverbes tels que « alors », « ainsi » ou « par conséquent ». « Par conséquent » peut parfois prêter à confusion en raison de la présence de la préposition « par », mais il fonctionne comme un adverbe pour exprimer la conséquence.
J’espère que ces reformulations vous conviennent. Si vous avez besoin de plus de modifications ou d’autres parties du texte reformulées, n’hésitez pas à le préciser.
Pour explorer plus en détail les relations entre cause et conséquence, cliquez ici pour lire l’article complet.
Exercices
Exercice 1 (page 1/2). Complétez chaque phrase.
Exercice 2 (page 2/2). Complétez chaque phrase. Attention aux indices !

Time’s up